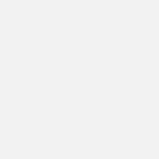1

IA, Robotique & Data
Et si l’avenir pouvait se prévoir comme la météo ?
De la psychohistoire d’Asimov aux modèles scientifiques d’aujourd’hui
5 mins
Et si nos sociétés étaient prévisibles ? Dans Fondation, le roman culte d’Isaac Asimov adapté en série par Apple TV+, un savant imagine une science capable de prévoir l’avenir collectif. Hari Seldon appelle cela la psychohistoire : une sorte de météo des civilisations.
Asimov lui-même expliquait que sa psychohistoire était inspirée des lois des gaz en physique : chaque molécule est imprévisible, mais des milliards de molécules obéissent à des lois statistiques. Les individus échappent aux calculs, les masses deviennent prévisibles.
Fiction brillante… mais qui interroge : dans notre monde réel, où les pandémies, les guerres et l’IA rebattent sans cesse les cartes, pourrait-on vraiment inventer une boussole pour le futur ?
Quand la fiction inspire la science
Chez Asimov, la recette fonctionne grâce à trois conditions :

- Beaucoup de monde : les comportements individuels se compensent, la moyenne devient prévisible.
- Des règles stables : pas de bouleversement brutal des institutions ou des technologies.
- Peu d’effet miroir : idéalement, les gens ne changent pas leur comportement parce qu’ils connaissent la prédiction.
Dans les romans, seul un petit cercle connaît le “Plan de Seldon”. Dans la série télévisée, au contraire, chacun essaie de suivre ou de contrecarrer ce plan, c’est un exemple parfait de réflexivité (La prédiction modifie le futur qu’elle voulait décrire).
Et dans notre monde ? On ne parle pas de prophéties, mais de statistiques de masse et de cycles collectifs. Les chercheurs savent que plus on zoome à l’échelle d’une personne, ou plus onpousse loin l’horizon temporel, plus l’incertitude croît. Mais sur le court etmoyen terme, certaines tendances deviennent lisibles. C’est le domaine de la prospective stratégique.
Ce que la fiction a (presque) bien vu
La cliodynamique : un baromètre des siècles
La cliodynamique, discipline émergente, propose d’analyser l’histoire comme un baromètre de longue durée. Le chercheur Peter Turchin a ainsi combiné démographie, inégalités, finances publiques, tensions politiques… Résultat :des cycles qui annoncent des périodes de forte instabilité.
Dès 2010, Turchin écrivait : “La société américaine entre dans une période de turbulence comparable à la guerre de Sécession.” Dix ansplus tard, la polarisation et la crise de 2020 ont semblé lui donner raison.
Pensez-y comme à un baromètre : il ne dit pas “émeute mardià 17h”, mais “zone de gros temps dans les prochaines années”.
Seshat : une base qui bouscule les idées reçues
La base de données Seshat compile, de façon homogène, des centaines de sociétés passées. Elle permet de tester des hypothèses longtemps admises :
“Les grands dieux moralisateurs ont permis de créer de grands empires.”
En regardant les données, on voit plutôt l’inverse : les grands empires apparaissent d’abord, et les dieux “qui surveillent” viennent a près ce qui est utiles pour stabiliser ce qui existe déjà.
“La pression militaire pousse les sociétés à se structurer.”
Confirmé : dans certaines régions, la compétition/guerre a effectivement accéléré l’émergence d’États plus complexes.
Bref, on garde les idées qui tiennent aux faits, on lâche celles qui ne collent pas.
Tournois de prévision et marchés prédictifs
Les tournois de prévision mettent des volontaires en compétition sur des questions chiffrées (“Cette loi sera-t-elle adoptée avant le 31/12 ?”). Les meilleurs, surnommés superforecasters, battent souvent les experts.
Pendant le COVID, certains ont anticipé plus vite que les agences de santé l’évolution des vagues épidémiques. Sur la guerre en Ukraine, ces tournois ont permis d’estimer la probabilité d’une escalade.
Cousine proche, les marchés prédictifs (ex. Polymarket), où le prix d’un contrat reflète une probabilité collective en temps réel. Lors des élections américaines, ils se sont parfois révélés plus justes que les sondages classiques.
Ces approches montrent qu’un signal collectif peut émerger. Mais dès que la prévision est connue, elle influence les comportements. C’est la réflexivité, la prédiction modifie parfois le futur qu’elle voulait seulement décrire.
Interlude, de quel “temps” parle-t-on ?
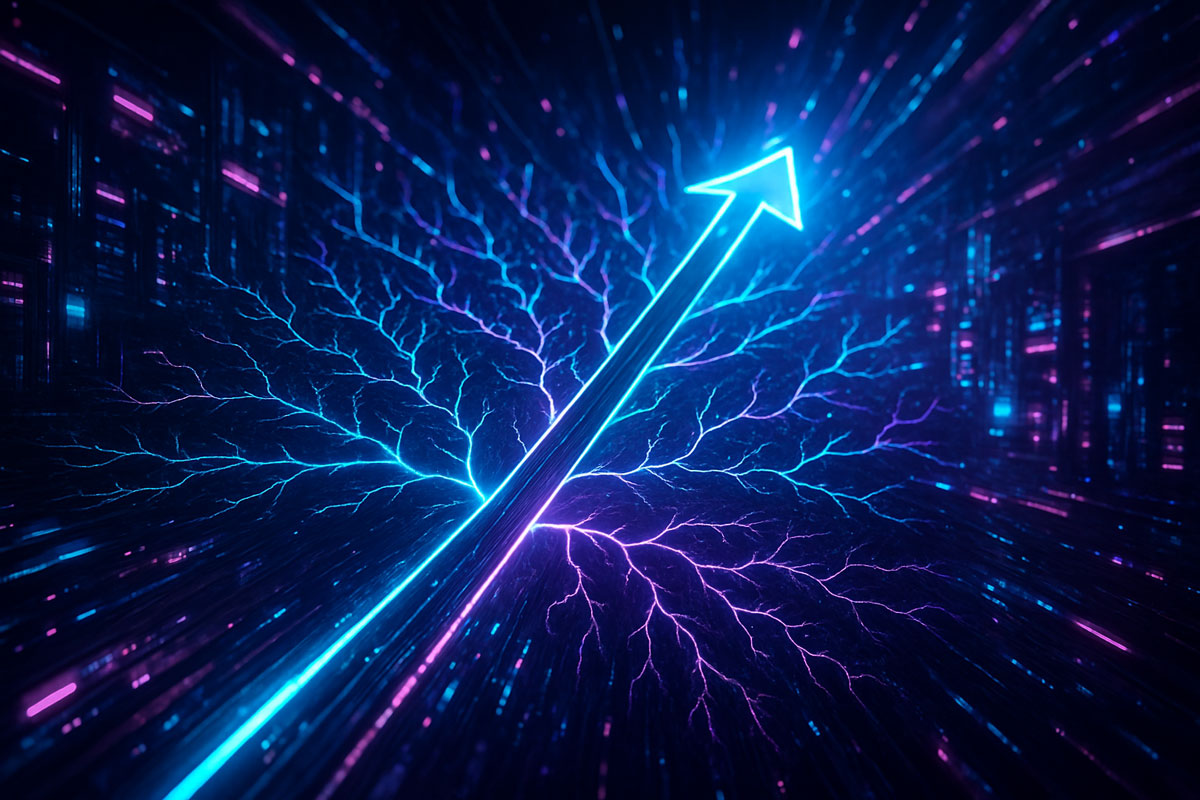
Avant de parler de prospective, il faut s’arrêter sur une question simple en apparence ; qu’est-ce que le temps ? Car selon la manière dont on le conçoit, la prévision n’a pas la même portée.
Depuis Einstein, nous savons que le temps n’est pas une horloge universelle qui tique partout de la même manière : il dépend de la vitesse et de la gravité de l’observateur. Par analogie, on pourrait dire que les sociétés aussi n’évoluent pas toutes au même rythme : certaines avancent très vite, d’autres semblent figées dans un autre âge.
Et pourtant, nous faisons tous l’expérience d’une direction commune : le temps file vers l’avant. C’est ce que les physiciens appellent la flèche du temps, dictée par l’entropie. Un verre brisé ne se recompose pas. Une révolution ou une pandémie laissent une trace durable, irréversible. L’histoire, comme la nature, porte la mémoire de ce qui a eu lieu.
Reste un dernier vertige, le temps est-il une ligne unique que nous partageons tous, ou bien un arbre qui se ramifie à chaque bifurcation ? Dans la première vision, il serait possible de dégager une tendance globale qui nous concerne tous. Dans la seconde, chaque choix ouvre une nouvelle branche, et l’avenir ressemble moins à une route qu’à un cône de possibles.
En résumé, le temps est relatif, irréversible et ouvert. Et c’est à partir de cette réalité qu’il faut penser la prévision sociale.
Pourquoi (et où) ça casse

Si la “psychohistoire moderne” existe déjà un peu, pourquoi n’avons-nous pas encore un Plan de Seldon ? Parce qu’à chaque fois qu’on pousse trop loin, les modèles se brisent.
Quand l’horizon s’allonge, le chaos s’invite
À court terme, certains modèles marchent bien. Mais dès qu’on étire l’horizon, l’effet papillon s’invite et les erreurs s’accumulent. Internet, les réseaux sociaux, la pandémie, aujourd’hui l’IA générative : en un instant, tout change, et les modèles d’hier deviennent caducs.
Quand la prédiction change la réalité
Une annonce de “crise probable” peut déclencher la panique… et provoquer la crise. À l’inverse, une annonce rassurante peut calmer les marchés et annuler la crise prédite. C’est la réflexivité, encore.
Quand la règle devient l’objectif
La tentation de transformer les mesures en objectifs c’est la loi de Goodhart. Une note moyenne peut servir d’indicateur du niveau scolaire. Mais dès qu’on en fait un critère d’évaluation des professeurs, la tentation est grande de gonfler artificiellement les notes. L’indicateur ne mesure plus rien de réel.
S’ajoute l’effet Lucas, (ça va parler aux investisseurs ^^) une règle connue devient une règle exploitée. Si chacun sait que la banque centrale baissera ses taux en cas de crise, les investisseurs prennent davantage de risques. Le modèle initial est invalidé par les comportements qu’il a lui-même déclenchés.
Mais la limite la plus redoutable reste la donnée. C’est le nerf… et le talon d’Achille de la prospective.
Elle est souvent incomplète (des trous dans la raquette), biaisée (certains groupes plus visibles que d’autres), indirecte (on mesure des “proxies” comme les tweets, pas la vraie opinion) et parfois délibérément orientée… les récits politiques et idéologiques brouillent les cartes.
Derrière une guerre “pour la démocratie” ou une intervention “humanitaire”, il peut y avoir un pipeline, une sphère d’influence ou un intérêt économique soigneusement caché. Résultat : les bases de données qu’on utilise sont déjà faussées en amont par la version officielle des faits.
Bref, “Garbage in, garbage out” : si les données sont mauvaises ou orientées, la prédiction l’est aussi. Et dans le domaine social et politique, il est rare qu’elles soient vraiment neutres. L’histoire est écrite par les vainqueurs… et leurs modèles de données aussi...
Conclusion : pas de prophétie, mais une boussole
Asimov nous a offert un mythe splendide : un savant qui lit l’avenir des peuples comme on lit les étoiles. Dans le réel, nous n’avons pas de “Plan de Seldon” et c’est tant mieux. Ce que nous avons, c’est une alliance nouvelle : l’IA comme instrument, la prospective stratégique comme méthode.
L’IA seule n’est pas une prophétesse. C’est un projecteur, un calculateur patient, capable de trier des données massives et de cartographier des futurs conditionnels. Mais sans méthode, ses projections tournent vite à la courbe stérile ou à l’illusion d’oracle.
Comme le résume le prospectiviste Hugues de Jouvenel “Prévoir n’est pas deviner, c’est éclairer les choix.”
Ensemble, ces deux dimensions se complètent :
- l’IA éclaire les chemins (données, signaux, probabilités),
- la méthode oriente le regard et la décision (scénarios, gouvernance, action).
Notre avenir n’est pas écrit, il est sculpté par nos choix. L’enjeu n’est pas de prédire un futur unique, mais de préparer plusieurs futurs et de choisir celui que nous voulons rendre plus probable.
L’IA n’est pas prête de remplacer votre intuition. Mais bien employée, elle lui donne des épaules (des données), un compas (des scénarios) et un carnet de vol. À nous de piloter.